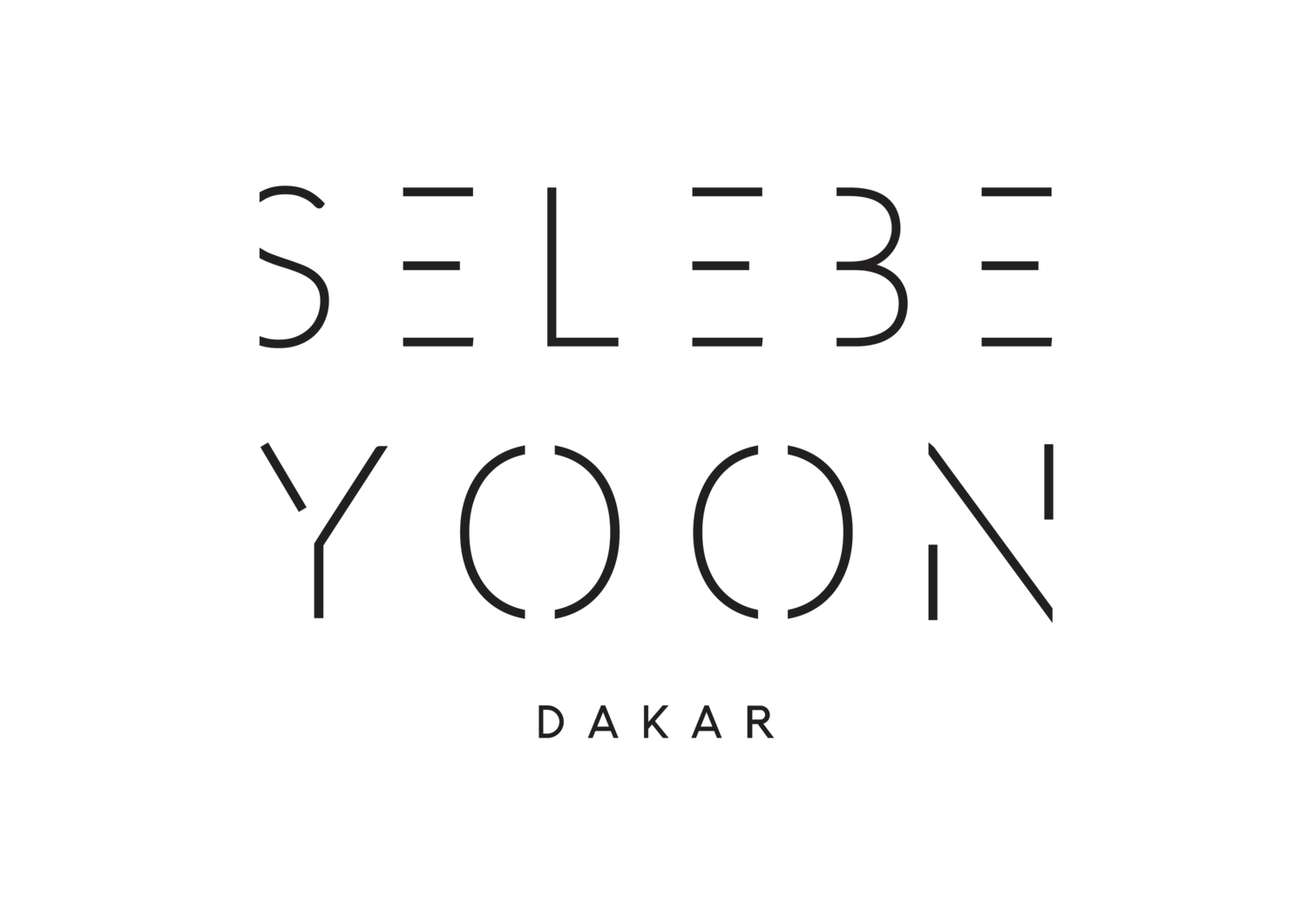Conversation avec les artistes : Export-Import
Younes Baba-Ali, Mbaye Diop, Hamedine Kane et Jennifer Houdrouge se sont entretenus avec Aude Tournaye, critique d'art et commissaire d'exposition indépendante, à l'occasion du vernissage de l'exposition "Export-Import" à Selebe Yoon.
Date de l'événement : 17/05 à 18h00 - Selebe Yoon
Aude Tournaye: Je voudrais d'abord te demander à toi, Jennifer, d'où est venue l'idée de faire cette exposition et de réunir ces trois artistes spécifiquement ?
Jennifer Houdrouge : L'idée de cette exposition vient d'un travail mené depuis plusieurs mois, ou même années pour certains. On avait fait une première collaboration à Paris l'année dernière. Les trois artistes travaillent sur les liens entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, mais à travers des prismes différents et des activités très différentes. Là, on parle de tennis, on parle de colombophilie, de lutte [sénégalaise], de pêche. Et donc c'était intéressant de voir comment ces liens avec l'Europe étaient explorés, tant d'un point de vue historique que contemporain.
Aude Tournaye: Pourriez-vous faire une petite introduction sur ce que vous exposez ? Et après on ira un peu plus dans les détails.
Hamedine Kane: C'est toujours un peu difficile de commenter des œuvres qui viennent d'être créées. Ce qui m'intéressait, c'est de parcourir le littoral sénégalais et de travailler avec les communautés de pêcheurs, de voir l’état de ce secteur, des usagers de la mer, autant d'un point de vue juridique que par intérêt et curiosité personnels. Je voulais aussi voir comment ce secteur s'intègre dans l'économie sénégalaise, dans l'économie africaine, ouest-africaine, et du point de vue alimentaire, du point de vue économique, des droits humains, de la conservation et enfin de l'exploitation des ressources. Je ne parle pas que des ressources halieutiques, mais aussi des ressources de nos territoires en général, comment les États ou des populations les gèrent et comment ça s'intègre dans l'économie mondiale. Enfin, je voulais voir quelle proposition un artiste peut faire lorsqu’il s’empare d’un tel sujet. Bien sûr que les artistes n'ont aucun pouvoir de changer fondamentalement les choses, mais je pense qu'ils ont un rôle important à jouer pour mobiliser et disponibiliser une façon de voir. L'intérêt, je pense, c'est de créer une distance assez juste pour qu'on puisse regarder ces choses-là d'une manière plus crue. C'est ça que j'ai essayé de faire - et c’est juste un début. C'est une première restitution. L'été dernier, pendant un mois, j'ai voyagé sur tout le littoral et j'ai collecté des informations, une sorte de matière première. Et là, c'est la première restitution formelle. Et ça va se poursuivre dans les années à venir.
Younes Baba-Ali: Pour ma part, je présente deux projets différents. Un qui a été réalisé en 2018 pour la Biennale [de Dakar], un projet sur la lutte sénégalaise. Ce n'est pas anodin - le choix des œuvres présentées a été fait avec Jennifer - notamment en clin d'œil avec les autres propositions des artistes, mais aussi en lien avec l'origine même du projet sur lequel je travaille actuellement, le projet LOFT - DKR autour de la colombophilie au Sénégal. C'est le monde, c'est l'univers, des lutteurs qui m'a fait découvrir la colombophilie. Je travaillais avec différents lutteurs amateurs dans des quartiers comme Amitié ou SICAP. En levant la tête, à chaque fois, je voyais des pigeons colorés, des pigeons roses ou verts fluos, et je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ces pigeons, ils tournoyaient autour de nous, autour des immeubles. On m'a fait comprendre qu'il y avait tout un monde parallèle qui existait sur les toits de Dakar, ce monde des colombophiles qui touche à une jeunesse assez incroyable. Il faut savoir que la moyenne d'âge des colombophiles au Sénégal est de 16 ans, contrairement à l'Europe où c'est plutôt une passion pour les seniors. Ici, quand on se retrouve dans des colombiers, des pigeonniers de quartiers, il y a le propriétaire et il y a une dizaine de jeunes passionnés entre 8 et 18 ans. C'est ce point de départ qui m'a donné envie de travailler sur la colombophilie. Étant basé en Belgique, je ne savais même pas que c’était le cœur de la colombophilie mondiale. Depuis le mois de novembre, je travaille sur le projet avec un pigeonnier expérimental qui se trouve à l'Hôtel de Ville de Dakar, pensé avec un architecte espagnol, Angel Montero, dans l'idée de construire un pigeonnier où on expérimente des nouvelles races de pigeons. Et en même temps, on travaille avec les nouvelles technologies en intégrant aux pigeons des trackers qui permettent de récupérer leurs données en temps réel pour ensuite faire une cartographie des déplacements. Dans le cadre de la galerie, dans l'exposition, il y a des éléments de recherche qui viennent questionner l'origine de la colombophilie au Sénégal, qui est encore une grande question pour moi. Je ne sais toujours pas comment cette passion a pris autant l'âme de la jeunesse sénégalaise!
Mbaye Diop: Le travail présenté ici est la suite d'une résidence à Selebe Yoon en 2022, dont le titre était « Balle de match », et c’était une réflexion sur l'architecture de Dakar. C'est vrai, quand on regarde les œuvres qui sont présentées, on se pose la question du lien entre l'architecture et le tennis. Alors le tennis n'est rien d'autre qu'un prétexte, une sorte de métaphore qui est utilisée pour montrer effectivement que nous sommes dans une lutte. Quand je parle de Dakar, nous sommes dans une lutte, dans un combat, dans une confrontation perpétuelle du point de vue architectural. Quand j'ai entamé la recherche, j'ai pu voir que les premiers colons qui sont arrivés au Sénégal pratiquaient ce sport. Du point de vue effectif, deux personnes suffisent pour faire ce sport, mais les règles sont complexes. Ils pratiquaient ce sport et tout autour des terrains, il y avait les riverains et les autochtones, il y avait les indigènes qui regardaient les matchs et peut-être même qui avaient envie de participer à ce jeu. Et mon idée première, c'est d'essayer de délocaliser ce sport pour l'amener dans la rue. Pourquoi dans la rue ? Parce qu'à Dakar, il n'y a pas d'aménagements sportifs qui donneraient la possibilité aux Dakarois de pouvoir s'exprimer. Donc, faisons du tennis dans la rue, faisons du tennis partout, même si on est en perpétuelle confrontation avec le danger.