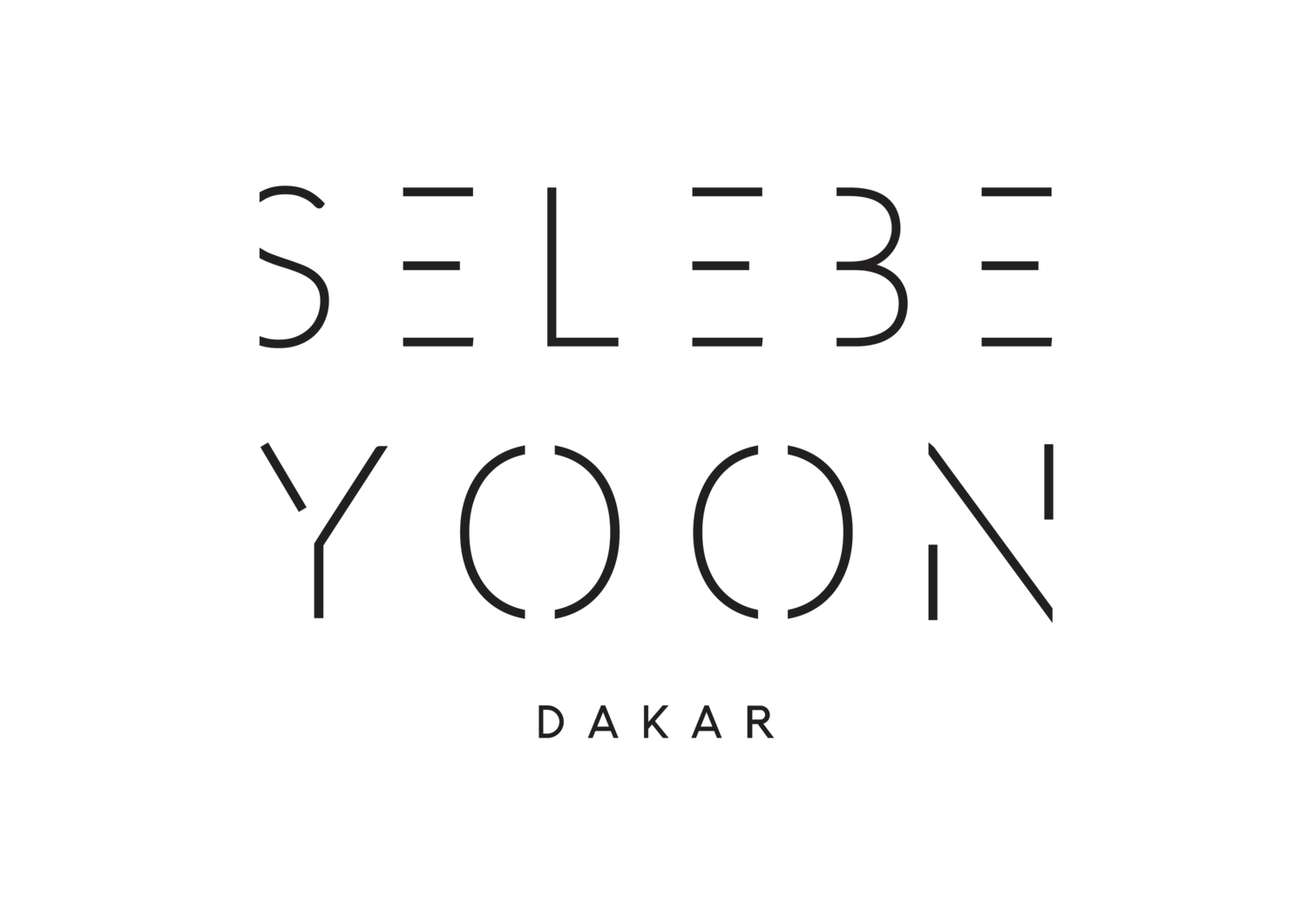Métamorphose de Dakar : Histoire et récits d'une ville de contrastes
Table ronde : Mbaye Diop, Annie Jouga, Carole Diop & Nzinga Mboup, Matthieu Jaccard
Date de l'événement : 9 février 2023 à 19 heures
MÉTAMORPHOSE DE DAKAR :
HISTOIRE ET ANECDOTES D'UNE VILLE DE CONTRASTES
Mbaye Diop, Annie Jouga, Carole Diop & Nzinga Mboup, Matthieu Jaccard / Modéré par Jennifer Houdrouge.
9 février 2023
Jennifer Houdrouge: Cette table ronde est organisée dans le cadre de l'exposition de Mbaye Diop, intitulée Balle de Match, qui a lieu à Selebe Yoon suite à sa résidence de deux mois. L’objectif de cette rencontre est d’avoir le regard d'architectes, de chercheurs, d'historiens de l'art sur les sujets soulevés dans l’exposition de Mbaye Diop et partager nos réflexions autour de l'architecture de Dakar. Balle de Match prend comme point de départ l'architecture de Dakar à travers une série de films, d'animations, de dessins et de peintures. Mbaye s’intéresse aux confrontations architecturales qui peuvent exister dans Dakar: entre des formes traditionnelles, des modèles infligés par l'histoire coloniale et la bétonisation de la ville. Le symbole du match de tennis est utilisé dans son travail pour évoquer l'état de compétition qui habite la ville. Basé à Genève, Dakar reste le sujet principal dans son travail. Mbaye, quelle était l'importance d'aborder, de questionner et d'étudier l'histoire architecturale de Dakar ? Pourquoi aborder cette ville dans ton travail ?
Mbaye Diop : Le point de départ de cette réflexion a commencé, si je ne me trompe pas, en 2010, lorsque j'ai été diplômé de l'École des Beaux-Arts de Dakar. Mon mémoire portait sur la gestion des déchets dans l'espace urbain de Dakar. J'ai travaillé sur ce sujet pendant quatre ans, en me demandant pourquoi il y a tant de déchets à Dakar, pourquoi la ville est sous la pression de tous ces déchets, de tous ces tas, de toutes ces affaires inachevées. J'ai voulu voir comment la ville se comportait en étudiant les ordures de Dakar, en parcourant les différents quartiers de Dakar. Je regardais les ordures et je prenais ce qui me semblait intéressant dans les ordures de chaque quartier pour voir le niveau de vie de ces gens. Je me suis particulièrement intéressée aux chaussures. Par exemple, aux Almadies, des chaussures jetées dans les ordures ne seraient pas la même forme d'expression que des chaussures jetées à Pikine. Et j'ai étudié l'évolution graphique, combien de temps ces chaussures avaient été portées, combien de personnes les avaient utilisées, ce qui a donné lieu à l'exposition juste après au Centre culturel Blaise Senghor sur le thème des chaussures usées. Donc, finalement, ce n'est pas un thème nouveau. Matthieu m'a proposé de faire ce travail sur l'architecture parce qu'il avait vu le film Colobane. Colobane, parce que j'habitais dans ce quartier et que lorsque j'étais encore à l'École des Beaux-Arts, j'ai eu mon premier téléphone portable pour pouvoir filmer et prendre des photos. Chaque fois que j'allais à Colobane, je prenais des photos et je faisais des bouts de films. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai voulu faire un film sur Colobane, car c'est un endroit qui me tient à cœur. J'ai fait le film pendant la période des Covid, et l'accent a été mis sur l'aspect dynamique de ce marché, sa transformation, son côté organique. Pour moi, le marché de Colobane est comme l'architecture de Dakar, qui change tout le temps, où rien n'est figé. Cela renvoie à mes premières recherches sur la gestion des déchets à Dakar, des éléments qui sont présents dans le décor urbain, où l'on trouve souvent des tas de gravats devant un bâtiment, ou des tas d'ordures. Ce qui veut dire que rien n'est fini, rien n'est fini, rien n'est fini. Tout est continu. Je compare souvent cela à Héraclite qui dit que tout bouge, tout devient. Pour moi, Dakar est vraiment une ville en devenir. C'est comme de la pâte à modeler, chacun peut lui donner la forme qu'il veut.
Jennifer Houdrouge: C'est très intéressant parce qu’il y a une vraie approche sensible vis-à-vis de la ville. Cette idée de chantier perpétuel me fait penser aux débris récupérés du bâtiment historique de la maternité “Le Dantec” qui a été détruite au cours de ta résidence. Ça soulève la question de ce patrimoine et de la préservation du patrimoine. Annie, voulez-vous rebondir là-dessus, avec un regard d’architecte ?
Annie Jouga: C'est vrai, la ville, ça bouge. Il y a quelque chose qui fait l'identité de Dakar. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on se réveille, pour que cette identité demeure. L’identité de Dakar, c'est une succession de plusieurs choses qui viennent se mettre les unes à côté des autres et qui se respectent. Je veux dire qu'on peut trouver dans Dakar plusieurs histoires, et il faut aller peut-être les chercher, mais elles existent. Carole et Nzinga en parleront mieux que moi sûrement, des premières traces de la ville de Dakar avec l'histoire des quartiers traditionnels, qu'on appelle Penc. Et là-dessus, l'administration coloniale est venue se greffer pour quadriller la ville. On voit des successions d'histoires, d'architectures qui s'entrelacent, qui se respectent et qui se parlent - et je crois que c'est ça qui fait la ville. C'est pas tant le chaos que ça. Je pense qu'il y a des endroits chaotiques, il y a des moments chaotiques, mais à Dakar, par rapport à beaucoup d'autres villes, on a la chance d'avoir cette histoire présente. C'est vrai qu'elle peut disparaître, mais je ne pense pas qu'elle disparaisse comme ça. Il y a une réflexion que nous devons tous faire. Les créateurs que nous sommes, les concepteurs que nous sommes, comment nous sommes dans cette ville. Ce n'est pas une histoire de Sénégalais, ce n'est pas une histoire de Dakarois, c'est une histoire de la ville. Mais il y a aussi des désastres plus importants. Je me souviens des professeurs qui nous racontaient l'histoire en Belgique: on traitait les architectes de crétins après la guerre, parce qu'il y avait un courant d'architectes belges qui avaient décidé qu'il fallait tout démolir. Donc ce n'est vraiment pas une histoire sénégalaise, c'est une histoire en général. On trouve ces problématiques partout. Il faut qu'il y ait une vision, des visions politiques qui soient associées avec des professionnels le plus large possible, pas simplement les architectes, parce que la ville n'est pas faite par les architectes mais aussi par bien d'autres personnes. On nous jette toujours la pierre en disant que c'est les architectes. La ville est heureusement faite par bien d'autres. Donc tous ces gens doivent contenir cette vision, et faire en sorte que, effectivement, l'identité existe pour les générations à venir.
Jennifer Houdrouge: Vous avez dit quelque chose que je retiens car c’est en lien avec les conversations qu'on a eues hier. Le fait de décrire la ville comme un espace chaotique, dans des termes considérés comme péjoratifs. Quelle lecture peut-on avoir de la ville, notamment à travers le regard de personnes n'étant jamais venues à Dakar ? Comment peut-on discerner les habitats traditionnels tels que les Penc, des espaces irréguliers et indésirables ? Carole et Nzinga, pourriez-vous nous parler de ce qu'est le Penc et pourquoi il est important ?
Carole Diop: Je vais rebondir un peu aussi sur ce que Mbaye a dit. Je sens que dans son travail, l'observation, c'est quelque chose de très important. Justement, l'observation, c'est ce qui nous a conduit à la recherche qu'on mène depuis 2019 qui s'appelle DAKARMORPHOSE. En se baladant dans la ville on découvre les espaces - on s'est intéressé à ces Penc, que je vais résumer en les décrivant tels des villages traditionnels des Lébous, mais c'est bien plus que ça. Un Penc, c'est l'endroit où se réunit la communauté. On pourrait dire qu'actuellement, là, on forme un Penc. Par exemple, si je prends le cas du Penc de Mbot, ce sont des descendants d'un ancêtre commun qui ont fondé ce Penc. Chaque Penc est lié à une famille en particulier. On s'intéresse à ces espaces en se posant la question de comment est-ce que la ville a évolué autour de ces structures et comment ces structures constituent des poches de résistance urbaines et sont une forme d'urbanité africaine importante, qui est présente et qui reste en place. Et quels sont les mécanismes aussi qui font que ces Penc restent en place, même s'ils sont bien réduits aujourd'hui.
Nzinga Mboup: Carole et moi, nous sommes sénégalaises. Je n’ai pas grandi ici, Carole a grandi ici, et nous avons toutes les deux étudié à l'étranger. Avant la réouverture du CUAD et d’une autre école privée, il n'y avait pas d'école d'architecture à Dakar pendant longtemps. Nous sommes dans un contexte où de nombreux architectes ont étudié à l'étranger, et qui, hormis l'expérience personnelle de la ville, ne comprennent pas la ville en tant que professionnel. Donc je pense que nous avons été, et moi particulièrement à mon retour au Sénégal, animé d'un désir de vouloir comprendre la ville d'un point de vue urbain, d'un point de vue architectural. La communauté des Lébous nous intéresse, étant considérée comme le peuple indigène de Dakar. Il est surtout très intéressant de voir que les origines des 12 Penc sont ici au Plateau, considéré comme le centre-ville de Dakar. A travers notre recherche, on tente d'imaginer ce à quoi ressemblait le Plateau et son évolution à travers les années. Nous vivons sur différents processus de transformation, comme l'histoire de tout Dakar - car des 12 villages originels, 6 sont restés dans le Plateau et 6 ont été déplacés à la Médina, à la suite d'une décision politique de ces migrations spatiales en 1914. Et par la suite, on voit que les migrations continuent dans la ville. Les gens de Fann Hoc ou Colobane sont issus du Penc de Hock, qui, le dernier emplacement, est sur l’avenue Lamine Gueye. Et avant, ces derniers étaient issus du village de Tan. On voit que ces migrations continuent, et ça crée un fil conducteur dans la ville. Et je pense globalement, au sujet de l'idée de la ville de Dakar comme chaotique, c'est que lorsqu'on continue à s'intéresser à l'histoire de la ville de Dakar, sa planification, son évolution, son extension, il y a quand même eu une forme de planification urbaine. En tout cas, ça répond à certaines logiques d'urbanisation dont on peut apprendre. Je prends l'exemple des SICAP dans le contexte d'un autre projet, “Habiter Dakar”, qui montre un intérêt pour la question du logement. L'histoire territoriale des SICAP et des SN-HLM, par exemple, nous informe sur une grosse partie de la ville, qui va du centre vers le nord. Lorsqu'on s'intéresse aux différents territoires de Dakar, on peut lire une histoire, une logique. Certes, dans les processus d'évolution toujours en cours, je pense qu'on peut constater que les architectes sont encore très peu présents. On est dans un pays avec moins de 300 architectes en exercice, enregistrés à l'ordre. Donc ça pose aussi la question, bien sûr, de la place qu'on peut avoir. Mais je pense que pour les architectes basés ici, comprendre la ville est quelque chose de très important. Ces travaux de recherche et d'histoire nous permettent de le faire et j'espère contribuer à la responsabilisation des architectures vis à vis de leur environnement.
Jennifer Houdrouge : Matthieu, vous êtes basé à Lausanne et les différents événements que vous avez organisés s'appellent " Learning from Dakar ". Quel est l'intérêt pour vous, qui vivez en Suisse, d'apprendre de Dakar ? Qu'avez-vous appris de Dakar ?
Matthieu Jaccard: C'est la première fois que je viens à Dakar. Jennifer, tu as a parlé de Daniel Sciboz - c'est un ami qui connait très bien Sénégal à travers des liens familiaux, il a notamment enseigné une année à Sup'imax, et il enseigne dans différentes écoles en Suisse dans le domaine du média design, et notamment à la HEAD de Genève. Quand il est venu à Dakar enseigner pendant une année, il a rencontré de nombreuses personnes de la scène artistique et du milieu architectural. Il a vu le travail de Carole Diop et Nzinga Mboup, DAKARMORPHOSE. En Suisse, entre 2000 et 2010, il se trouve qu'il y a eu deux Prix Pritzker: Herzog & de Meuron et Gert Zumthor. Il y avait une sorte de grande vogue de l'architecture suisse au début des années 2000. La Suisse s'intéressait à ce qui se faisait à différents endroits du monde. Il y a un institut de recherche fondé par l'école politique fédérale de Zurich, le Studio Basel, avec à la tête de ce studio Pierre de Meuron. Ce studio a étudié les grandes villes du monde, parce que c'est un sujet qui ne touche pas la Suisse, mais en même temps, les villes grandissent à travers le monde et nous, en tant qu'architectes, ça nous intéresse de prendre part au débat. Il y a eu plusieurs semestres dans différentes villes du monde, à chaque fois des mégapoles : Nairobi, Le Caire, Mumbai, etc. De tout ça est né un ouvrage, African Modernism, piloté par l’architecte Manuel Herz. Daniel Sciboz, quand il est venu à Dakar, a pu voir DAKARMORPHOSE, mais qu'il a vu aussi au Goethe Institut African Modernism. Cette expression, déjà entendue en Suisse, est véhiculée par des chercheurs suisses aux étudiants suisses - mais ces recherches n’arrivent jamais aux villes où elles ont été réalisées, comme Dakar ou Nairobi. C'était le début du projet “Apprendre de Dakar”, le retour de Daniel Sciboz de Dakar en Suisse. On s'intéresse beaucoup à la question de la relation entre la Suisse et le colonialisme. Ça fait une quinzaine d'années que c'est un sujet qui est de plus en plus débattu en Suisse. Il y avait cette idée que la Suisse n'a pas d'accès à la mer. Ce n'est pas comme la France, ce n'est pas comme la Grande-Bretagne. La Suisse, depuis très longtemps, c'est les banques, les grandes entreprises, les mercenaires. Mais la Suisse a pleinement participé à la question coloniale. À cet arrière-plan, Daniel Sciboz m'a proposé de mettre en place une série d'événements qui réunit des architectes et des artistes de Dakar. Et c'est pour ça qu'on a invité, pour commencer, Carole Diop et Nzinga Mboup. Ensuite, on a invité l'École des Mutants, ce collectif fondé à Dakar par Hamedine Kane et Stéphane Verlet-Bottero. Ils travaillent notamment avec Oulimata Gueye qui avait mis sur pied l’exposition “UFA - l'Université des Futurs Africains” à Nantes. Puis, on a invité Mbaye Diop pour une performance parce qu'on a vu son film Colobane. Tout d'un coup, il y avait une série de protagonistes qui disaient des choses très intéressantes d'une ville qu'on connaissait de nom, mais pas vraiment. Et donc après l'invitation qui a été faite à Carole et Nzinga, on a fait cette invitation à l’Ecole des Mutants. Et ce qui était amusant, c'est que tout d'un coup, on a vu qu'il y avait énormément de liens entre la Suisse et le cinéma de Djibril Diop Mambéty. Les deux derniers films de Mambéty, La petite vendeuse de soleil et Le franc, ont été produits par une Suissesse. Et le chef de la caméra pour Touki Bouki est Contras’ City, aussi suisse. On a pu inviter de nombreuses personnes à Lausanne, c'était une sorte de moment fort par rapport à cette question de ce qu'on pouvait apprendre de Dakar. La recherche DAKARMORPHOSE, j'en parle tout le temps, parce que cette idée de dire qu'il y a un patrimoine très colonial qui existe à Dakar, dont on avait assez peu parlé, qui est tellement brillamment valorisé par ses études, je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre beaucoup.
Jennifer Houdrouge: Ce qui est intéressant, à partir de nos discussions, c’est d'apprendre que, par exemple, le Musée Dynamique de Dakar est une reproduction, d'une certaine manière, du musée qui est à Neuchâtel, c'est ça ?
Matthieu Jaccard: Oui, disons que cette histoire, c'est la question de la place de la Suisse dans le monde. La Suisse, c'est les organisations internationales, c'est 8 millions de personnes, c'est Nestlé, c'est 33% du pétrole mondial qui est négocié à Genève, c'est l'affaire de SIM, une grande entreprise de béton basée en Suisse. Et la Suisse, c'est aussi des organisations internationales, c'est l'UNESCO, (la Société des Nations se trouvait à Genève avant que l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, trouve son siège à New York) et qui dit organisation internationale, dit aussi expertise. Il y a beaucoup d'experts, d'expertes de nationalité suisse, qui se sont retrouvés à différents endroits du monde au moment de la décolonisation, notamment au Sénégal. Le principal conseiller de Senghor au moment de l'indépendance, par rapport à la question culturelle, c'était un Suisse qui s'appelle Jean Gabus, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel.
Jennifer Houdrouge : Cela signifie donc que Dakar a été un laboratoire d'expérimentation architecturale et urbaine, ce qui nous amène à la question suivante : Y a-t-il une identité de l'architecture sénégalaise ? Annie, je sais que dans votre enseignement, vous avez fait en sorte que les étudiants puissent développer un modèle propre à Dakar, et qu'ils désapprennent en quelque sorte les modèles qu'ils ont appris à l'étranger.
Annie Jouga : La ville de Dakar a une identité. Et dans cette identité, il y a des architectures qui se côtoient. Ce n'est pas l'architecture sénégalaise, c'est l'architecture de la ville de Dakar. L'identité d'une ville est faite d'un certain nombre de choses qui s'assemblent et créent une osmose. Cela va des quelques rares vendeurs de fromage de Dakar, inhérents à la presqu'île, à la maison coloniale, à l'immeuble Selebe Yoon datant des années 40, à toute l'architecture du 20ème siècle des grands ensembles. La place de l'Indépendance est l'identité de Dakar. Les SICAP sont l'identité de la ville. Les SICAP datent des années 1950. C'est l'identité de la ville de Dakar. L'architecture sénégalaise - disons l'architecture traditionnelle - se retrouve aussi au Sénégal. Dans les années 70 et 80, il y avait une architecture basée sur ce qui n'était ni défini ni codifié, mais qui était un principe philosophique énoncé par le président Senghor, le "parallélisme asymétrique". Et tout le monde voulait savoir ce que c'était, ce qu'était le parallélisme asymétrique. Pour le définir, le parallélisme asymétrique n'est pas un principe architectural, c'est une manière d'être. C'est une façon d'être nous-mêmes, à la fois en architecture et dans d'autres domaines culturels. Senghor a créé ce concept et les architectes des années 1980 ont essayé de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, ce qui a donné lieu à de nombreux bâtiments de l'Université de Dakar : les amphithéâtres, la bibliothèque, les archives, le CICES dont tout le monde parle. Il y a eu d'autres bâtiments, dont certains ont été démolis, notamment celui de la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat sur l'avenue Roosevelt. C'est une tendance qui a voulu devenir "l'architecture sénégalaise". Ce que nous sommes censés apprendre à nos étudiants, c'est d'abord de regarder ce qui se passe autour d'eux, au Sénégal et ensuite ailleurs, bien au-delà. Je ne pense pas qu'il faille les focaliser là-dessus, mais plutôt les orienter vers la recherche, à la fois en laboratoire et dans le matériau le plus approprié, qui correspondra ou répondra davantage à une forme, à une manière de vivre et à une manière d'être. Je ne pense pas que l'on puisse parler d'architecture sénégalaise, parce que c'est tellement réducteur de ne regarder que notre petit Sénégal, qui est une invention très récente, trop récente, pour en faire une architecture.
Nzinga Mboup: Je trouve la discussion autour de l'identité architecturale sénégalaise très intéressante, parce que tu es une architecte qui pratique, et ça m'interpelle énormément. Et effectivement, je suis contente d’en parler. Je pense à l'effort le plus singulier de vouloir définir une architecture sénégalaise. Je l'ai vu dans la loi d'urbanisme de 1978, qui parle de plusieurs choses assez intéressantes. Le parallélisme asymétrique, certes, est à interpréter, mais je le comprends comme une question de rythme, une géométrie un peu différente, qu'on pourrait retrouver aussi en musique, et pas que dans l'architecture. Il y a d'autres éléments qui parlent de ce texte de loi, dont les architectures d’éléments architecturaux d'inspiration soudano-sahélienne. Je l'ai toujours lu dans un premier temps, interprété, comme des références très stylistiques. Il y avait plus de prescriptions, même sur la couleur, pour les couleurs des bâtiments, qui devaient être des couleurs terre ou du Sahel. Et quelqu'un m'a fait remarquer, bien après, qu’il y avait une forme de volonté d'avoir une architecture bio-climatique dans ce texte. C'était leur interprétation, parce que soudano-sahélien, c'est une continuité climatique. Dans l’exposition, de voir les débris de la maternité Le Dantec donc sa destruction, c’est un drame pour plein de raisons sur lesquelles on peut débattre. Le fait de voir le gravat et de voir un tas de béton, et de voir tous ces bâtiments, anciens, détruits, dont on parle maintenant, et de penser à leur matérialité devenant juste béton, et simultanément Mbaye qui parle de déchets de la ville, et de sa transformation, des déchets de ces bâtiments. Que deviennent-ils, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on détruit un bâtiment en béton, en tarpin, de ciment ? Que deviennent tous ces gravats ?
Carole Diop: Je voudrais juste rebondir sur la question de la ville comme terrain d'expérimentation. À mon sens, oui, Dakar l’a été parce que beaucoup d’architectes qui ont construit des bâtiments au début du XXe, les premiers bâtiments de la ville - la Chambre de Commerce, la Préfecture qui était la première école de garçons, l'Hôtel de Ville, le premier Palais de Justice qui est aujourd'hui le Ministère des Réformes étrangères - c'est beaucoup d'architectes qui venaient de France, qui étaient soit sortis d'école, soit ayant séjournés en France et qui venaient expérimenter ici. Mais je vais rejoindre ce que disait Annie, c'est-à-dire qu'on est dans une ville où on a la chance d'avoir une richesse en termes de styles architecturaux. On peut passer d'une maison de commerce à Kermel à un bâtiment de style empire, comme l'Hôtel de Ville, à une tour, comme la tour de la BCEAO ou l'immeuble du Fayçal.
Jennifer Houdrouge: Tout à fait, et je pense que c'était l'objectif de cette exposition, de proposer une déambulation à travers des bâtiments, à travers des quartiers, à travers même des bâtiments qui ont été détruits, et représentés dans une forme fantomatique. Mbaye, comment le tennis t’es venu comme une image pour parler de l'architecture ?
Mbaye Diop : Alors, par rapport à cette métaphore du tennis, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet, les premiers documents que j'ai consultés mentionnaient où les colons s'étaient installés au Sénégal et j'ai voulu voir leurs activités. D'un point de vue architectural, je me suis rendu compte en consultant ces documents que les premières formes de construction étaient des constructions importées de France. C'était des constructions typiquement françaises pour faciliter, je ne dirais pas l'intégration, mais le bien-être de tous ces travailleurs civils français. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est leur espace de travail, qui était concis ou aménagé selon un modèle français. Et le troisième élément, ce sont les discothèques ou les bars que ces gens fréquentaient, eux aussi aménagés selon un modèle français. Enfin, le quatrième élément est le court de tennis. Ces gens avaient un terrain de tennis où ils pouvaient jouer, où ils pouvaient pratiquer ce sport. Avant qu'ils n'arrivent, il y avait peut-être déjà une architecture, une façon de vivre ou une façon de construire qui existait. Alors comment ces deux éléments vont-ils cohabiter ? Il y aura peut-être une concurrence entre ces deux formes d'architecture. Nous pourrions utiliser le terme d'architecture indigène et d'architecture coloniale ou moderniste, quel que soit le nom qu'on lui donne. J'ai commencé à utiliser la métaphore du tennis de compétition. J'ai observé Dakar et autour d'un bâtiment construit à l'époque coloniale, surtout près des marchés, il y a plusieurs constructions éphémères qui se greffent sur ces architectures. C'est comme si elles étaient toutes rassemblées autour d'un grand arbre. L'exemple le plus illustratif est le marché de Kermel. Il y a le bâtiment, qui est assez imposant et très beau, et tout autour il y a des constructions éphémères faites par les marchands ou par des gens qui veulent trouver leur place. Cette forme de confrontation, cette lutte, cette forme d'échange, c'est comme un match de tennis où il n'y a pas de balle. Chacun essaie de montrer qu'il est là, dans un climat qui reste assez joyeux. Je me promenais dans la ville avec ma raquette de tennis et à chaque fois que je voyais quelqu'un, je lui demandais: "Tu peux jouer au tennis ici dans la rue?" ? Et je les photographiais ou les filmais, puis je redessinais avec le moins de traits possible pour accentuer l'expérience de l'expression corporelle ou du visage de la personne. À Dakar, il n'y a pas beaucoup d'espace pour jouer. Les gens sont beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, est-ce que la façon dont la maison est construite et la façon dont elle est agencée répond vraiment à nos aspirations ? Pourquoi sommes-nous tout le temps dehors ? Pourquoi ne restons-nous pas à l'intérieur de nos maisons ?
Annie Jouga: J'ai été interpellée par le titre Balle de Match. Qu’est-ce que la balle de match au tennis ? Je ne joue pas au tennis, mais je crois que c'est la dernière balle qui déterminera le gagnant. Donc, je me demande qui gagne ?
Jennifer Houdrouge: Oui, en plus, le titre évoque une fin qui est proche aussi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la plupart des œuvres, la balle est absente, ce sont des personnes en attente du jeu.
Nzinga Mboup : En ce qui concerne Dakar, qui s'étend dans un continuum urbain, je pense que les limites sont assez claires, simplement d'un point de vue géographique. C'est une forme de péninsule assez particulière, avec des lacs et des marais. Je pense donc que l'expansion de la ville est très limitée par sa géographie. De mon point de vue, elle est très définie et très limitée. Et c'est aussi, dans une certaine mesure, la raison pour laquelle la ville devient de plus en plus verticale. J'habite dans un R+5, et le bâtiment R+5 voisin vient d'être démoli. Je me demande ce qui va suivre. Il n'y a pas que des maisons basses qui sont démolies, il y a aussi des immeubles. Et je pense que cela devrait aussi nous inciter à réfléchir à la manière dont cette ville va évoluer, et jusqu'où elle peut aller, parce que je pense que son expansion est limitée, en fait. Malheureusement, ou heureusement.
Annie Jouga : Il y a la périphérie de Dakar, Dakar n'est pas Rufisque, Rufisque n'est pas Guediawaye, Pikine n'est pas Rufisque, etc. Les choses sont assez circonscrites. Et puis nous avons des frontières naturelles, nos corniches. Et je pense que nous pouvons et devons sauver cette identité. La ville a une identité. Parce que cette identité est ancrée dans l'histoire. Aujourd'hui, nous devons travailler à une autre échelle, nous devons travailler verticalement. Et faire partie de ce Dakar. Que fait l'Ordre des architectes ? C'est vrai que l'Ordre des architectes doit avoir quelque chose à dire, mais je ne pense pas qu'il y ait que l'Ordre des architectes, il y a beaucoup d'individus dans les associations. On met toujours le bébé sur le dos des soi-disant professionnels - c'est vrai que l'Ordre des architectes ne joue pas son rôle, je suis d'accord - mais en tant qu'individus, nous devons tous réagir aussi. Encore une fois, la ville n'est pas seulement l'affaire des architectes, c'est l'affaire de tous. Si l'on pense que la démolition de la maternité du Dantec ou du marché Sandaga, ou du CICES qui date de 1974, pose un problème, chacun doit pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la profession, notamment des architectes. C'est peut-être ce qui manque aussi au Sénégal. Je n'aime pas trop parler de société civile, mais il y a des associations qui dénoncent cet accaparement des terres. Toutes les forêts de baobabs sont morcelées, vendues, achetées. Les forêts de baobabs font partie de notre patrimoine, d'autant plus quand on sait ce qu'elles peuvent apporter en termes de durabilité et de climat. Il y a donc de plus en plus d'associations, notamment sur la côte de Ouakam, mais il y en a sur toutes les côtes. Et quand on démolit un bâtiment, de la même manière, je pense qu'on devrait pouvoir se parler en groupe. Les réseaux ici fonctionnent très bien, comme partout dans le monde. Je veux dire que c'est aussi une occasion de s'exprimer. C'est vrai que tout ne peut pas être sauvé ou sauvegardé, mais je ne sais pas si vous le savez, tout le quartier de la place de l'Indépendance, le ministère des Affaires étrangères que vous avez évoqué tout à l'heure, tout cela risque d'être démoli. Il y a de grands architectes étrangers qui travaillent sur des bâtiments qui risquent d'être démolis. Il en va de même pour l'avenue Peytavin, où l'on trouve des cèdres centenaires et des bâtiments de type militaire jusqu'à Sandaga.
Matthieu Jaccard: Je pense que la force du travail de Mbaye Diop, c'est de montrer l’interaction entre la société et l'architecture. La DAKARMORPHOSE montre comment la forme des Penc, si j'ai bien compris, n'est pas qu'une construction, une manière de mettre en forme l'espace, mais aussi l'expression d'une complexité de relations internes d’une société. Je travaille sur la question des associations d'architectes, comme L'Union internationale des architectes, née à Lausanne en 1948. Aujourd'hui, c'est une association qui représente des centaines de milliers d'architectes à travers le monde, parce que chaque personne membre d'une association d'architectes devient membre de cette union internationale des architectes. Et à Dakar, il y a 300 personnes qui peuvent être représentées par cette association. Ensuite, dans une école comme celle de Lausanne, il y a 300 personnes par an qui sortent avec un titre qui leur permet de participer aux compétitions internationales. Et je pense que c'est important de ne pas tout d'un coup dire, voilà comment on peut adapter Dakar à ce qui se fait, d'une manière générale, ce qui a été déjà établi, comme quelque part un ordre des architectes. Je pense que c'est plus important de regarder ce qu'il y a à Dakar, et c'est peut-être cette notion d'identité et d'intégration. Qu'est-ce qui a su résister dans cette compétition, dans ce match qui est encore là et qui peut peut-être faire en sorte qu'on va pouvoir se sauver ? Je pense que c'est plus important de mettre l'accent sur ce qui a été fait, qui a été miraculeusement préservé, et qui va peut-être nous permettre d'en sortir. Et nous avions organisé trois tables rondes, justement, avec Carole et Nzinga. La première, c'était la DAKARMORPHOSE. La deuxième, Nzinga avait montré le travail de Worofila, comment on peut travailler la terre plutôt que le béton. Et c'est intéressant parce que ça rejoignait des initiatives qui sont prises aussi en Suisse pour tout d'un coup éviter de construire en béton. Puis ensuite, on a travaillé sur la question de Dakar en image et de la force qu'a cette ville quand on ne sépare pas l'architecture du reste.
Nzinga Mboup : Je pense que toutes ces conversations nous poussent à interpeller celui qui finalement fait la ville. Lorsqu'on étudie le logement en particulier, on voit l'évolution des différentes typologies de logements qui sont plus ou moins planifiées et qui répondent à certaines logiques. Et l’une des choses, l’un des éléments un peu plus politiques si on réfléchit à plus grande échelle, c'est l’évolution dans les années... Il y a des maisons, il y a des architectures traditionnelles avec les Penc, il y a les maisons coloniales avec la colonisation. En 1951, les SICAP sont créées, donc au moment des indépendances, qui se construisent de façon croissante, jusque les années fin 1970 à peu près. Et des éléments comme le crash pétrolier, la création de la banque de l'habitat, du fonds monétaire international, montre la faiblesse que l'État peut avoir à pourvoir et, finalement, à faire la ville. Je trouve qu'il y a une évolution pendant les années 1980-90, avec les programmes d'ajustement structurel, la dévaluation, et une baisse de la main-mise de l'État. On espérait que l'État puisse avoir un élément régulateur. Mais de plus en plus, lorsqu'on regarde ici à Dakar il faut s'intéresser pour savoir qui construit. Qui sont les maîtres d'ouvrage ? C'est des privés. Une façon très facile de se faire de l'argent, c'est de faire des logements de plus en plus luxueux. Et puis c'est un refuge aussi. Donc ça, c'est l’un des problèmes, l’une des faiblesses. Et de l'autre côté, il y a toujours cette ville qui se fait par les gens pour des questions de survie, finalement, une ville fonctionnelle. Je ne peux que parler en tant qu'architecte, donc peut-être à mes congénères, mais certainement aussi à la société, aux habitants, aux personnes qui occupent la ville, de pouvoir au moins s'interroger sur ce qui pourrait être. Parce qu’il y a eu des exemples qui nous ont montré qu'on aurait pu avoir une autre ville. Et je pense que c'est important d'avoir une vision globale, et pas uniquement les juxtapositions et successions de projets individuels pour des raisons financières, de gains financiers et pas urbains. On le voit avec les derniers hivernages. Il y a une grande réflexion à faire autour de comment construire ensemble pour que la ville soit vivable.
Jennifer Houdrouge : Tout à fait. Une vision globale où tout le monde a le droit de penser la ville, et où les artistes peuvent aussi avoir leur propre vision de la ville pour l'imaginer.
Mbaye Diop: Je pense que ce qui est intéressant, c'est juste de poser la problématique, à inviter tout le monde à réfléchir, pas dans le même sens, mais qu'on réfléchisse ensemble par rapport à toutes ces questions. Je n'ai pas de réponse, honnêtement, par rapport au devenir de l’architecture de Dakar. C'est juste une observation, c'est juste des questionnements que je partage avec le public, avec tout le monde. Et chacun prend ce qu'il veut prendre.
Annie Jouga: Juste pour réagir un peu à la question, je dirais qu'il y a des initiatives qui se mettent en place et il y a des moyens d'inventer et de s’adapter autrement. Nzinga et Carole ont proposé une réflexion là-dessus et ont commencé à proposer des pistes de solutions. Je pense qu'il faut surtout construire intelligemment, construire avec... Je ne vais pas dire des matériaux locaux, mais je vais plutôt parler de matériaux biosourcés ou disponibles ici, que ce soit de la terre ou du ciment. Et on peut le faire quel que soit le matériau qu'on utilise, et construire des formes qui seraient adaptées aux besoins des habitants. Et je pense que c'est des éléments de réponse comme ça que « Habiter Dakar » commence à initier, mais aussi au reflet dans leur pratique architecturale et le fait qu'ils proposent une architecture bioclimatique.
Paticipant·e·s
Annie Jouga
Annie Jouga (née en 1953 à Dakar) est une architecte DPLG (diplômée par le gouvernement) depuis 1978 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la Villette (France).
Elle a été adjointe au maire de Gorée de 2002 à 2022, conseillère élue de la ville de Dakar de 2014 à 2022, et présidente de la commission mobilité et infrastructures urbaines. Aujourd'hui, elle est l'administratrice de l'Ecole Universitaire d'Architecture de Dakar, qu'elle a créée en 2008 avec deux collègues architectes, dans laquelle elle sensibilise les étudiants en patrimoine au Patrimoine Urbain et Architectural. Tout au long de sa carrière, elle a œuvré pour la qualité de la ville et de son architecture, la corniche de Dakar, le bord de mer et les trottoirs de la ville.
Matthieu Jaccard
Matthieu Jaccard est architecte et historien de l’art indépendant. Après un apprentissage de dessinateur en bâtiment à Lausanne, puis des études d’architecture à Fribourg, il pratique à Lausanne et Berlin entre 1995 et 1997.
De 1997 à 2008, il étudie les Lettres à l’Université de Lausanne tout en organisant des expositions. Il est commissaire des deux premières éditions de la Distinction Romande d’Architecture, en 2006 et 2010. De 2008 à 2014, il se partage entre Lausanne, Zurich et Paris. A partir de 2014, il collabore avec le Théâtre Vidy-Lausanne pour des expositions. Ses activités se déploient principalement au travers de projets collectifs qui mêlent architecture et différentes formes d’expression artistique avec la volonté de répondre par la culture aux défis de notre temps. En 2022, il lance avec Daniel Sciboz le cycle d'événements Apprendre de Dakar accueilli par différentes institutions lausannoises. La même année il est lauréat du Prix de la culture du bâti de la Fondation vaudoise pour la culture
Crédit photo : Sara Bastai
Carole Diop
Carole Diop est une architecte diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine (Paris, France). Elle travaille et vit à Dakar. Elle est la fondatrice de "Afrikadaa", un magazine interactif d'art contemporain, de design et d'architecture qui redéfinit la relation entre les territoires, les idées et les mouvements artistiques. . Ainsi elle préside l'association Afrikadaa à Dakar, qui participe activement à la vie culturelle sénégalaise. En décembre 2021, Carole initie les "Balades Architecturales", des visites guidées qui allient histoire et architecture. Elle participe également au Partcours, un événement artistique annuel qui réunit plusieurs espaces artistiques dakarois, depuis 2015.
Nzinga Mboup
Nzinga Mboup est une architecte sénégalo-camerounaise basée à Dakar depuis 5 ans. Après avoir étudié à l'Université de Pretoria (Afrique du Sud), elle a travaillé pendant deux ans à Johannesburg, avant de poursuivre avec un master en architecture à l'Université de Westminster à Londres. Elle a ensuite travaillé pendant trois ans chez Adjaye Associates à Londres. En 2018, elle a formé WOROFILA, un collectif d'architectes et d'ingénieurs spécialisés dans la construction en terre et autres matériaux bio-sourcés, dans le but de promouvoir une architecture durable et en harmonie avec le climat. Nzinga est chercheuse et autrice avec l'architecte Carole Diop de DAKARMORPHOSE, un travail de recherche sur l'évolution des villages lébous et du patrimoine urbain et culturel de la ville de Dakar, qui aura fait l'objet d'expositions lors de Dak'Art 2018 et 2022 des éditions Partcours en 2018 et 2019. Nzinga est également co-auteur de l'étude HABITER DAKAR, qui retrace l'histoire urbaine de Dakar et soulève les conditions critiques de la question du logement.
Mbaye Diop
Mbaye Diop (né en 1981 à Richard Toll, Sénégal) est diplômé des Beaux-Arts de Dakar en 2010, titulaire d'un master en cinéma de l'Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal (2017), et récemment diplômé d'un master en "Pratiques artistiques contemporaines" à la HEAD, Genève. Il est un observateur attentif des paysages urbains quotidiens et des formes architecturales du Sénégal, ainsi que des mouvements socio-politiques qui redéfinissent continuellement les liens qui existent entre le continent africain et l'Occident. Qu'il s'agisse de vidéo, de performance, de dessin ou d'installation, la singularité de son travail réside dans son utilisation exclusive et quasi obsessionnelle du noir et blanc, lui permettant de neutraliser les scènes représentées. Plus récemment, Mbaye Diop a fait partie de la sélection officielle de la Biennale Dak'Art de Dakar (2022) et a reçu le prix de l'UEMOA pour son installation " De l'arbre à palabre à l'arbre numérique " ainsi que la Biennale de Genève - Jardin des sculptures (2022).